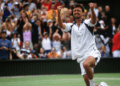Wimbledon aime les traditions au point de repasser les gazons. Puis 2001 a servi un programme spécial : finale un lundi, tribunes rajeunies par une billetterie “premier arrivé, premier assis”, et un héros sorti de la file “wild card”. Goran Ivanišević, classé 125e mondial, débarque en invité de dernière minute et s’incruste jusqu’au bout, comme un convive qui finit par découper le gâteau. Face à lui, Pat Rafter, joueur modèle de l’art en souplesse, prêt pour la photo de une. Résultat : cinq sets haletants, et une histoire qui ridiculise toutes les brochures sur la méritocratie parfaite. Score gravé : 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7. Lundi 9 juillet, “People’s Monday”. Un Centre Court plus bruyant que d’habitude, et une finale vendue à la pièce, sans l’étiquette guindée des habitués. Une comédie humaine où la dernière réplique revient à l’homme que personne n’attendait. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Avant d’en arriver là, Ivanišević a réglé un dossier national : Tim Henman, idole locale, éteint sur trois jours à cause des pluies, de l’obscurité et d’un timing élastique. Un feuilleton commencé le vendredi, interrompu le samedi, conclu le dimanche en quatre jeux pour décrocher sa place en finale. Le Croate avait déjà connu la salle des trophées… par la porte des regrets : finaliste perdant en 1992, 1994 et 1998, toujours sur ce même gazon qui pardonne rarement. Cette fois, la dynamique est inversée. Rafter, roublard au filet, se nourrit des passages à vide adverses ; Ivanišević, service en catapulte et nerfs en montagnes russes, trouve ce qu’on appelle pudiquement “la balle de plus”. Il ne s’agit pas d’un conte de fées, juste d’un joueur qui, entre crampes de carrière et dos aux clous, délivre la semaine parfaite au moment idoine. Le décor “People’s Monday” fait le reste : ambiance populaire, timing décalé, centre d’exposition transformé en stade vivant. La dramaturgie ne ment pas : le Croate est le premier – et à ce jour l’unique – lauréat d’un Majeur en simple masculin avec une invitation, titre empoché en sortant d’un classement à trois chiffres. Pas de flou artistique : 125e avant le tournoi, 16e après. Les chiffres tirent la révérence, l’histoire s’incline. WIRED+1
La finale, elle, ressemble à un exercice de funambulisme. Premier set avalé par Ivanišević, réaction immédiate de Rafter, troisième acte repris par le Croate, quatrième offert à l’Australien qui remet tout à niveau. Le cinquième devient un marathon sans détour, ponctué par ces points où le service-volée s’accroche à la moindre tranche de ligne. Et puis 9–7, verdict scellé, bras qui retombent, visage qui craque. Les images de l’accolade paternelle et du trophée brandi n’ont pas besoin de commentaire : c’est la fois où Wimbledon a compris que les scripts les plus coûteux se réécrivent avec un ticket de fortune. La suite appartient à la géographie : Split, Zagreb et toutes les places croates improvisent un concert de klaxons. L’All England Club, lui, conserve ce moment sous verre, souvenir d’un lundi républicain où l’on a autorisé l’improbable à rentrer par la grande porte. Les palmarès adorent la logique ; les foules, elles, préfèrent les exceptions bien servies. Au bout de cette journée, une évidence demeure : les classements avaient une opinion, le terrain en a eu une autre. Et c’est toujours le terrain qui signe.