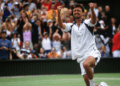Deux anciens coéquipiers de Texas A&M, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, se retrouvent en finale d’un Masters 1000. Ridicule ? Non. Impressionnant ? Oui, surtout si l’on relit les petites histoires de vestiaire et les habitudes de travail qui, visiblement, n’étaient pas du théâtre universitaire. Un de leurs anciens camarades raconte, et ses souvenirs valent mieux que la plupart des dossiers de recrutement.
Valentin apparaît comme l’exemple parfait du joueur qui croit vraiment en lui. Son ancien coéquipier rapporte ce message envoyé avant l’US Open : « Je vais tenter ma chance en qualifs à Shanghai, un parcours de malade peut vite arriver. » La confiance n’est pas du vent chez lui, argue le témoin : clutch sur les gros points, tie-break comme meilleur tennis, ace sur chaque point important de son service. Preuves chiffrées entre guillemets : Vacherot l’avait battu 7-6, 6-4 lors d’un tournoi universitaire, et il aurait infligé un 6-2, 6-3 à Brandon Nakashima en match universitaire. Les anecdotes servent le propos : pas d’envolée lyrique, juste des faits que l’on range dans la colonne « ça, ça marche ».
Arthur, lui, a la conversion physique forcenée. Arrivé “grand maigre” au campus, il est devenu une « bête physique », selon le même récit. La routine n’était pas une option : musculation, repas sérieux, arrivée une heure avant les séances pour étirer et faire du travail individuel. Le rôle de grand frère lui collait aussi bien : il restait parfois après l’entraînement pour aider les plus jeunes. L’exemple collectif est martelé plusieurs fois : ni Arthur ni Val n’étaient des solistes égocentriques ; ils poussaient l’équipe. Une seule absence d’entraînement en quatre ans — pour aller voir sa copine, devenue depuis sa femme — a même déclenché la colère du coach adjoint Kevin O’Shea. Les coéquipiers ont choisi le silence et la défense collective. On aime cette loyauté ; on la remarque aussi chez les pros, quand elle existe.
On termine par la part d’humanité et d’absurde : les farces d’Arthur. La fameuse histoire des sardines glissées dans une machine à laver, la pratique des « coco » (petits coups taquins sur le crâne) et les blagues d’avion qui annonçaient au micro un pseudo-75e anniversaire à Kevin O’Shea forment le décor. Les rires et la camaraderie n’ont pas tué l’exigence ni le boulot quotidien. C’est paradoxal : la même bande qui planifiait des blagues a aussi bâti des routines de travail rigoureuses. Le résultat ? Deux anciens « Aggies » en finale d’un Masters 1000. Le reste, c’est à la finale de le confirmer.