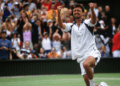Wimbledon adore polir ses habitudes, puis 2002 a imposé une mise à jour : finale 100 % Williams sur le Centre Court. Serena d’un côté, Venus de l’autre, et un tableau qui avait cessé d’être un escalier pour devenir un arbre généalogique. L’événement avait tout pour affoler les gardiens du bon goût : affrontement entre sœurs, puissance à plein régime, gazon cisaillé par des appuis carnivores. Résultat sans fioritures : 7-6 (4), 6-3 pour Serena. Une première coupe à Londres pour la cadette, et une impression solide : le circuit allait devoir s’habituer à voir deux joueuses de la même maison discuter de la vaisselle, c’est-à-dire des trophées.
Le contexte donne la mesure. Venus arrivait en double tenante du titre, patronne officielle de Church Road en 2000 et 2001, mètre étalon du service-volée ajusté au millimètre. Serena sortait d’un printemps décapant, Roland-Garros en poche, confiance pleine et pied lourd. Deux trajectoires parallèles, un sommet évident : Londres en juillet. Les puristes qui fantasmaient une finale de dentellière ont compris très vite : ce serait une démonstration de géométrie agressive, prise de balle précoce, retours à bout portant, lignes utilisées comme des rails. Le premier set s’est verrouillé à la hauteur : service dominant des deux côtés, bras tenu, pas de cadeau. Tie-break, et Serena plante la banderole. Dans la foulée, le second acte bascule sur la densité en fond de court, ces échanges où la cadence de la cadette use, compresse, finit par fissurer le filet adverse. Venus garde la tenue, pousse, défend sa couronne avec dignité, mais la tendance est nette : les points décisifs migrent du côté de Serena, sans drame ni nervosité. La sœur aînée avait installé le règne, la cadette en a changé la serrure.
Saisir la portée ne demande pas de lyrisme. Ce samedi-là entérine une évidence sportive : deux joueuses issues du même salon contrôlent le sommet. L’argument d’autorité tient sur trois lignes : Venus, meilleure référence du gazon depuis deux ans ; Serena, bras de levier et regard bas, qui empoche son premier Wimbledon en deux sets. Les grilles du classement s’en souviendront à peine la cérémonie achevée : la n° 1 passe de l’aînée à la cadette, et la hiérarchie s’aligne sur le terrain. Les mois suivants ne feront que confirmer la monotonie spectaculaire du casting : grandes finales en famille, trophées qui ne quittent la maison que pour poser ailleurs sur la cheminée. On peut regretter les récits édulcorés, on préférera observer la mécanique : préparation ciselée, service posé comme un verdict, retour compact, mental verrouillé. La discussion publique sur « l’équité entre sœurs » aura tenté quelques détours moraux ; le rectangle vert n’a pas fait de philosophie. Il a noté la précision, validé la puissance, salué la constance.
Reste l’essentiel : cette finale a redessiné le protocole. Les spectateurs n’ont pas assisté à un drame familial, mais à une succession organisée. Le public a reçu un mode d’emploi sans sous-titres : si les Williams sont au même endroit, vous verrez un bras de fer d’ingénierie, pas de théâtre. Le match n’a pas offert un scénario tordu ; il a livré un verdict net, produit par une exécution tenace. Les archives retiendront une première londonienne pour Serena, une résistance propre de Venus, et l’ouverture d’un cycle où les grandes scènes ont souvent fonctionné comme une réunion de famille. Le reste relève du folklore. Les classements changent, les vitrines se remplissent, les débats s’épuisent. Sur le gazon, la morale se résume à une équation : si deux sœurs dictent la vitesse, le tennis s’adapte. Et il s’est adapté.