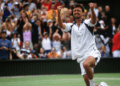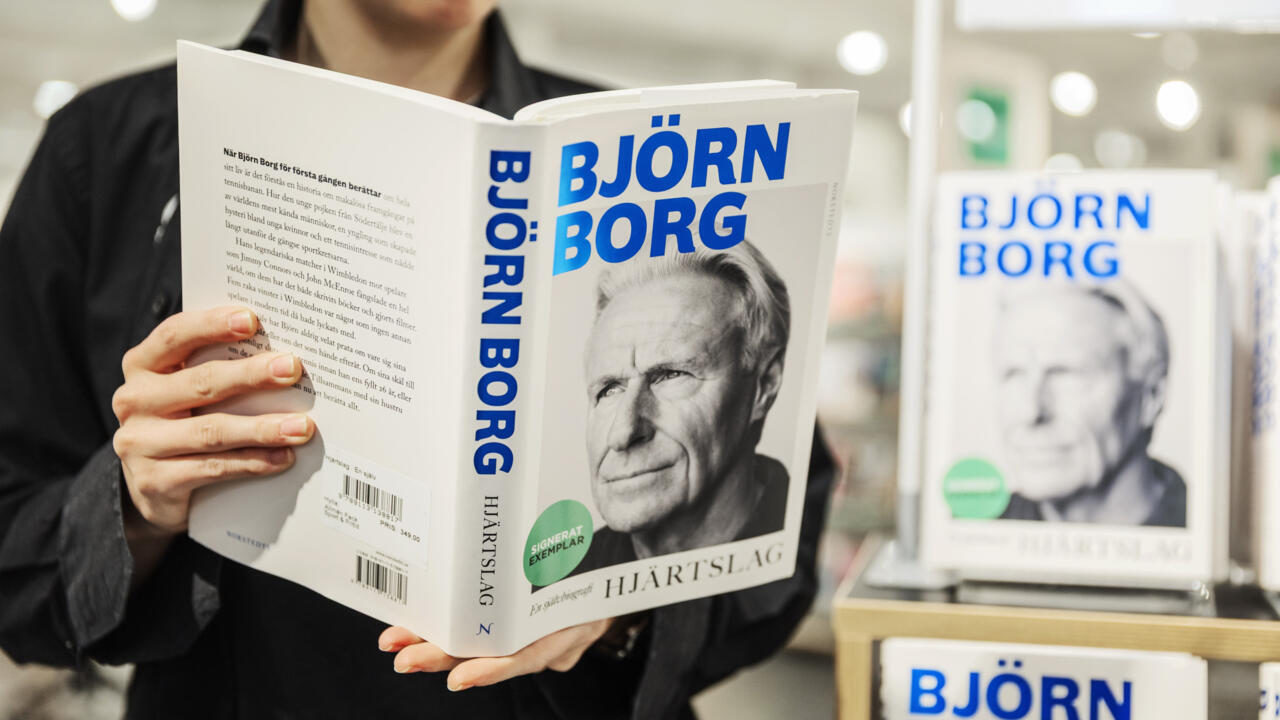On pourrait appeler ça de la psychologie à la tronçonneuse. Guillaume Peyre, sans poésie, explique comment préparer Terence face à Jannik Sinner : détruire les barrières mentales et balayer tout protocole du respect. « Le mec, il est comme toi, il a deux bras, deux jambes, et il est là pour te casser la gueule, donc tu vas faire pareil », lance-t-il, avec la délicatesse d’un poing dans la mâchoire. Bruyant et direct, le conseil tient en deux axes revendiqués : ignorer le palmarès — « Tu n’écoutes pas » quand les speakers déroulent — et jouer son jeu, agressif et frontal.
Sur le court, la stratégie ne cache pas son nom. Peyre l’affirme noir sur blanc : « Quoi qu’il arrive, tu ne le laisses pas jouer, sinon il va te découper ». Traduction : pression permanente, coups droits latéraux du gaucher pour le déborder et longs de ligne gagnants. Le plan a été appliqué à Cincinnati, en demi-finales : Sinner l’a emporté 7-6 (4), 6-2. Le résultat est factuel ; l’analyse, elle, est emphatique. Peyre regrette une double faute dans le tie-break — détail qu’il tient pour déterminant — et affirme que, si Terence avait pris ce jeu décisif, « Sinner, victime d’un coup de chaud au début du deuxième, n’aurait pas continué ». Pas de statistique d’appui dans le texte, uniquement l’intuition du coach et l’issue : un tie-break perdu, un set plié, un match bouclé.
Finalement, la leçon du jour tient en une vision musclée du coaching : un mélange de boxe métaphorique et d’injonctions sans fioriture. Peyre compare le tennis à la boxe — « sauf qu’en boxe tu reçois les coups directement » — pour mieux justifier l’état d’esprit voulu. On ressort de ces confidences avec deux certitudes simples et peu confortables : la tactique offensive voulue était claire, et un moment de fragilité (une double faute) a suffi à renverser la balance. Reste un sous-entendu que le sport est d’abord mental, et que parfois, la rhétorique martiale d’un coach tient lieu d’armure. À défaut d’une victoire, il reste la conviction bien tenue d’avoir presque touché le but — et la consolation sceptique que le « presque » du coaching laisse souvent un goût amer.