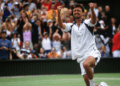Inventé en 1891 par James Naismith pour occuper des étudiants en salle, le basket part d’une idée d’école primaire : un ballon, deux paniers de pêches cloués en hauteur, treize règles griffonnées à la hâte, et merci de ne pas se rentrer dedans. Premier match ? Neuf contre neuf, score 1–0, ambiance chambranle et ballon de foot. On se dit que l’affaire va rester un passe-temps d’hiver. Mauvais pronostic : le jeu prend, voyage, s’installe dans les gymnases de tout un continent et s’offre, sans avoir l’air, une machine à mythes. Candidat idéal pour les grands récits : simple à comprendre, difficile à dompter, et parfaitement calibré pour qu’un génie rende tout le monde ridicule en deux possessions.
Les réglages arrivent en cadence. Le dribble tarde, puis s’invite quand les ballons rebondissent enfin correctement ; le cinq contre cinq devient la norme ; les paniers cessent d’emprisonner la balle (bonne idée, au passage). En 1932, la FIBA structure l’international ; en 1936, Berlin découvre la discipline aux Jeux, sous la pluie, terrain extérieur en prime. Le show parallèle existe aussi : les Harlem Globetrotters tournent la planète dès la fin des années 1920, preuve qu’on peut divertir sans abîmer le jeu. Pendant ce temps, la filière américaine se professionnalise : la BAA naît en 1946, fusionne avec la NBL en 1949, et devient la NBA. Le sablier moderne tombe en 1954 : vingt-quatre secondes qui empêchent les siestes collectives et forcent la main aux attaquants. Et la porte s’ouvre enfin en 1950 aux joueurs afro-américains — Chuck Cooper drafté, Nat Clifton signé, Earl Lloyd premier à fouler le parquet — preuve que le progrès sportif finit parfois par frapper plus fort que les habitudes.
Reste l’ingrédient qui change la géométrie : la ligne à trois points. L’ABA en 1967 la teste, la NBA l’adopte en 1979, et l’ère des snipers commence. Longtemps gadget tactique, elle devient colonne vertébrale lorsque l’arithmétique entre au vestiaire. L’espace s’étire, le pick-and-roll se récite, les intérieurs apprennent à tirer pour survivre, et l’idée de poste fixe prend sa retraite anticipée. Les années 1990 offrent une démonstration diplomatique : Barcelone 1992, la “Dream Team” rappelle à la planète que la NBA ne vend pas que des maillots. L’effet domino suit : explosion du vivier international, stars formées en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, qui débarquent et tordent les hiérarchies locales. Au passage, 1996 voit naître la WNBA (première saison en 1997) : un championnat structuré, des dynasties, et une base de fans qui grossit sans réclamer la permission des sceptiques.
On pourrait faire mine de regretter l’innocence perdue — les paniers en bois, la craie au tableau, les systèmes à trois passes — mais l’histoire raconte autre chose : le basket s’améliore parce qu’il se simplifie en surface et se complexifie en profondeur. Les règles ont traqué l’ennui ; la technique a polissé les gestes ; l’analyse a révélé l’évidence froide du rendement. Des Jeux de 1936 aux salles surchauffées d’aujourd’hui, des 24 secondes au tir à trois points, des pionniers anonymes à l’ère des superstars globales, le fil ne casse pas : courir, créer un angle, trouver le tir. Sarcastique, on dira que tout a été vu. Moqueur, on concédera que tout reste à refaire dès l’entre-deux suivant. Piquant, on note que l’« évolution » n’a pas d’issue finale : demain, un coach invente un spacing plus radical, une joueuse ajoute un tir impossible, un pivot casse encore une ligne invisible. Fin de l’histoire ? Non. Simplement la pause entre deux possessions.